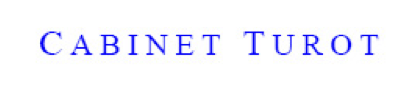La CJUE juge, par un arrêt de grande chambre, que la Charte des droits fondamentaux confère aux personnes physiques le droit de garder le silence lors des procédures administratives pouvant mener à une sanction. En France, où le droit au silence n’est reconnu qu’en procédure pénale, bien des procédures administratives devront intégrer le respect de cette garantie, pour peu qu’elles mettent en œuvre le droit de l’Union.
Le droit au silence aura sa place dans certains contrôles fiscaux, susceptibles d’entraîner des sanctions à caractère pénal – qui sont de plus en plus systématiques, au point que l’administration fiscale est devenue une sorte de parquet spécialisé. L’« obligation de coopération du contribuable », de plus en plus souvent invoquée par l’administration fiscale et qui, sans être inscrite dans le CGI, inspire un nombre croissant de lois astreignant les contribuables à des contraintes nouvelles, ne doit-elle pas recevoir des limites ? Les sanctions punissant un refus de communication ou l’opposition à contrôle fiscal, qui risquent de contraindre un contribuable à coopérer à sa propre incrimination, devront faire réserve du droit au silence.
L’onde de choc de ce grand arrêt ne manquera pas de se propager, au-delà de ce droit, à d’autres garanties : la répression de la fraude fiscale est en train de devenir une matière hybride, mi-administrative, mi-pénale, relevant des garanties de la présomption d’innocence et du procès équitable.
1 – Si le contribuable réclame le droit au silence, ce n’est pas qu’il espère ne plus entendre parler des services fiscaux, mais seulement qu’il souhaite quant à lui se taire devant certaines questions ou demandes de documents, pour ne pas contribuer à sa propre incrimination au regard de sanctions administratives et pénales. C’est ce droit que met vivement en lumière un arrêt historique de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), rendu en grande chambre, qui marque un élargissement, d’autant plus remarqué qu’il était inattendu des commentateurs, de sa jurisprudence relative au droit de garder le silence, dans le contexte d’une procédure pouvant mener à une sanction.
On savait depuis quelque trente ans, pour l’avoir entendu proclamer d’abord à Strasbourg puis à Luxembourg et rue de Montpensier, que le droit au silence s’applique à la procédure « pénale », au sens autonome que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a su donner à ce terme. Ceci a été rappelé tout récemment parle Conseil constitutionnel dans une décision du 4 mars 2021 3 : saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions de l’article 396 du Code de procédure pénale, le juge constitutionnel décide qu’elles portent atteinte à cette garantie en ne prévoyant pas que le prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention doit être informé de son droit de se taire. La grande question qui restait en suspens était de savoir si le droit au silence s’applique au cours d’une enquête administrative. La Cour constitutionnelle italienne en a saisi la Cour de justice de l’Union Européenne, par une question préjudicielle d’interprétation de la Charte des droits fondamentaux, à propos d’une procédure d’enquête boursière concernant – ce qui ne s’était pas présenté jusqu’ici devant la CJUE – des personnes physiques.
La CJUE était placée devant une possible – et embarrassante – contrariété entre le règlement sur les abus de marché et la Charte des droits fondamentaux. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) avait infligé à une personne physique, DB, des sanctions administratives pour un délit d’initié, et surtout (c’est ce qui donne lieu à cette question) une sanction pour défaut de coopération, car DB, convoqué en sa qualité de personne informée des faits, avait refusé de répondre aux questions qui lui avaient été adressées.
Son recours contre ces sanctions ayant été rejeté, DB a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui a adressé à la Corte Costituzionale une question de constitutionnalité portant sur la disposition de droit italien qui sanctionne le défaut d’obtempérer aux demandes de la Consob.
La Corte Costituzionale, relevant que la disposition critiquée a été adoptée en exécution d’une directive et d’un règlement, a interrogé la CJUE sur la compatibilité de ces actes avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, plus particulièrement, avec le droit de garder le silence.
La Cour de justice, réunie en grande chambre, reconnaît l’existence, en faveur d’une personne physique, d’un droit au silence, protégé par l’article 47, deuxième alinéa, et l’article 48 de la Charte. Elle proclame que le droit au silence, qui est au cœur de la notion de procès équitable, s’oppose à ce qu’une personne physique « accusée » soit sanctionnée pour son refus de fournir à une autorité administrative des réponses qui pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives à caractère pénal ou sa responsabilité pénale. La Cour en déduit que sa jurisprudence obligeant les entreprises soupçonnées de comportements anticoncurrentiels, à fournir des informations établissant leur responsabilité, ne peut pas s’appliquer pour établir la portée du droit au silence d’une
personne physique.
On notera incidemment qu’elle ne censure pas la directive et le règlement litigieux : plutôt que de constater une violation de la Charte par ces textes de droit dérivé, la Cour préfère leur donner une interprétation neutralisante, de façon à les rendre compatibles avec la garantie qu’exige la Charte. Le juge européen découvre, ce que la Corte costituzionale n’avait pas su voir, que la directive et le règlement permettent aux États membres de respecter ce droit : le fait que ces textes n’excluent pas explicitement les personnes physiques de cette menace de sanction ne saurait, explique un peu laborieusement la Cour, affecter la validité de ces actes ; cette exclusion allait tellement de soi qu’il était inutile que la directive ou le règlement le précise.
La CJUE pousse ici à ses limites la technique de l’interprétation neutralisante, dont use beaucoup (et peut-être trop) depuis quelques années le Conseil constitutionnel, lorsqu’il préfère amender la loi par ses réserves d’interprétations plutôt que de constater son incompatibilité avec une norme supérieure. Dans cette affaire comme dans d’autres, on ressent que la Cour de justice est déterminée à atténuer, quoiqu’il en coûte en rigueur juridique, les dégâts que la Charte des droits fondamentaux, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, risque de provoquer dans le droit dérivé de l’Union.
La généralisation du droit au silence devrait nous semble-t-il inciter au réexamen de certaines procédures administratives, notamment fiscales. Le droit de ne pas s’accuser soi-même se déclinera-t-il en un droit de ne pas contribuer à son propre redressement ?
L’affirmation progressive du droit au silence, de Londres à Luxembourg en passant par Washington
2 – Les tribunaux anglais commencèrent à administrer, au XIIIe siècle, ce qui était appelé le sermentex officio aux personnes soupçonnées d’hérésie. Puis le même serment fut utilisé par la Court of Star pour détecter et condamner ceux qui pensaient mal du roi.C’est pour bannir à jamais cette obligation de répondre sous serment à une question incriminante que s’imposa la doctrine de common law selon laquelle tout suspect avait le droit de refuser de témoigner contre lui-même.
La seconde moitié du XVIIIe siècle a vu l’adoption du cinquième amendement à la Constitution des États-Unis, proclamant : « Nul ne sera […] contraint de témoigner contre lui-même dans le cadre d’une
procédure pénale. ». L’avis rendu par la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Miranda c/ Arizona, en 1966, inspire aujourd’hui la majorité des systèmes juridiques : le droit au silence est souvent appelé le principe Miranda. À l’heure actuelle, dans presque tous les commissariats de police du monde, les suspects entendent avant interrogatoire une formule à peu près ainsi conçue : « Vous avez le droit de garder le silence. Si vous n’en faites pas usage, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous ». Cette formule est inspirée de l’arrêt Miranda.
Ce principe n’avait franchi ni la Manche ni l’Atlantique avant que la CEDH ne l’impose, alors même qu’il ne figure pas dans la Convention européenne, comme corollaire de la notion de procès équitable : tout accusé a le droit de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination. La proclamation de ce droit intervient pour la première fois dans l’arrêt Funke c/ France, de manière assez abrupte, puis avec une motivation plus développée dans les affaires John Murray c/ Royaume-Uni, puis Saunders c/ Royaume-Uni(GC).
La Cour manifestait une certaine audace prétorienne, en affirmant que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination constitue une norme généralement reconnue, alors qu’en réalité cette norme était encore à l’époque essentiellement anglo-saxonne, et n’était pas reconnue, notamment, en France.
La Cour a confirmé son libéralisme en jugeant que la garantie n’est pas limitée aux déclarations auto-incriminantes. La question a été posée devant elle : est-il nécessaire que les propos obtenus sous la
contrainte aient un caractère incriminant pour que le droit au silence soit méconnu ? Dans l’affaire Saunders, le Gouvernement faisait fortement valoir qu’aucun des propos tenus par le requérant au cours des entretiens n’était auto-incriminant et queM. Saunders avait uniquement fourni des réponses le disculpant. La Cour écarte cette analyse : le droit pour l’accusé de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne saurait se limiter aux aveux de méfaits. Une déclaration obtenue sous la contrainte, qui semble, de prime abord, dépourvue de caractère incriminant – par exemple de simples informations sur des questions de fait – peut par la suite être utilisée dans une procédure pénale à l’appui de l’accusation, par exemple pour contredire d’autres déclarations de l’accusé ou saper sa crédibilité.
Force est toutefois de signaler que la CEDH a paru un moment faire un pas en arrière dans son arrêt O’Halloran et Francis c/ Royaume-Uni(GC) 12 du 29 juin 2007, qui a été depuis systématiquement invoqué par les gouvernements pour restreindre la portée de cette garantie. Il est donc nécessaire de s’étendre un peu sur cet arrêt, dont on peut prévoir qu’il continuera à être cité pour justifier certaines formes de contraintes en matière d’enquête.
L’Austin-Healey Sprite de M. O’Halloran roulait à une vitesse de 111 km/h sur une autoroute britannique où la vitesse était – étrangement –limitée à 65 km/h, lorsqu’elle passa devant le radar d’un Traffic Constable. La voiture de M. Francis, elle, fut photographiée à la vitesse de 75 km/h à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h. Tant M. O’Halloran que M. Francis furent par la suite informés que la
police allait poursuivre le conducteur des véhicules photographiés.
Ils étaient priés d’indiquer le nom et l’adresse complets de ce conducteur, et menacés courtoisement de poursuites en cas de refus de communiquer ces informations. Pour le plus grand bonheur des juristes assoiffés de jurisprudence sur la question, ils réagirent de façon opposée : M. O’Halloran répondit qu’il était le conducteur du véhicule, tandis queM. Francis invoqua son droit de garder le silence pour ne pas contribuer à son incrimination. M. O’Halloran fut déclaré coupable de dépassement de vitesse et condamné à une amende de 100 GBP. M. Francis fut condamné, pour avoir refusé de donner le nom de la personne qui était au volant du véhicule, à une amende plus lourde que celle de M. O’Halloran, alors que son excès de vitesse était bien moindre : il dut verser une amende de 750 GBP.
M. O’Halloran se plaignit d’avoir été condamné sur la base de la déclaration qu’il avait été contraint de fournir, sous la menace d’une sanction. M. Francis, lui, se plaignit qu’en le sanctionnant pour ne pas avoir donné des preuves de l’infraction dont on le soupçonnait, on avait porté atteinte à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et ce d’autant plus que l’amende était nettement supérieure à celle qui lui aurait été infligée s’il avait reconnu être coupable d’excès de vitesse.
La Cour jugea que, eu égard à la nature particulière de la réglementation en cause et au caractère limité des informations sollicitées, il n’avait pas été porté atteinte à la substance même du droit des requérants de garder le silence et de ne pas contribuer à leur propre incrimination.
Cependant, la solution décevante de l’arrêt faisait appel à un concept bien particulier qui est celui du « consentement implicite », comme l’a souligné, pour le critiquer, l’opinion dissidente du juge Myjer. La Cour a conclu à la non-violation en raison d’un consentement implicite des automobilistes, car : « Les personnes qui choisissent de posséder et de conduire des véhicules à moteur peuvent passer pour avoir accepté certaines responsabilités et obligations qui font partie de la réglementation applicable aux véhicules à moteur ».
Nos lecteurs auront immédiatement remarqué que la notion de consentement implicite est difficilement transposable à la matière fiscale, car si chacun est libre de conduire ou de ne pas conduire une voiture, la même liberté n’est pas encore reconnue s’agissant de ne pas payer ses impôts. Et surtout, cette solution est restée cantonnée aux situations dans lesquelles les investigations sont très limitées. C’est au regard du caractère limité des informations sollicitées des deux automobilistes –désignation du conducteur – que la Cour estime qu’il n’a pas été porté atteinte à la substance même du droit des requérants de garder le silence. C’est en effet l’importance des investigations qui active le droit au silence, puisque la Cour souligne que, dans les affaires où elle a reconnu une violation du droit au silence, les requérants étaient soumis au pouvoir d’exiger la production de « papiers et documents
de toute nature relatifs aux opérations intéressant le service », ou de « documents, etc., présentant de l’importance pour la taxation ».
De même, dans l’affaire Heaney et McGuinness, les requérants devaient « rendre pleinement compte de [leurs] déplacements et de [leurs] actes durant une période donnée » et, dans l’affaire Shannon, des informations pouvaient être demandées au sujet de toute question dont l’enquêteur financier pensait qu’elle avait trait à l’enquête.
À l’aune de ce critère, les investigations que, par exemple, l’administration fiscale est autorisée légalement à mener auprès d’un contribuable par l’exercice de son droit de communication ou de son
droit de contrôle sont susceptibles de constituer des investigations importantes, renvoyant vers l’affaire J. B. c/ Suisse plutôt que vers l’affaire O’Halloran.
Si l’on garde à l’esprit cette double spécificité de l’affaire O’Halloran, la jurisprudence de la CEDH se présente globalement comme très protectrice du droit au silence, sous son double aspect : protection de l’accusé contre la possibilité d’utiliser contre lui des déclarations obtenues sous la contrainte, et protection contre les sanctions dont il peut être menacé s’il exerce son droit au silence.
Jusqu’à quel point la Cour de justice de l’Union européenne allait-elle suivre la CEDH ? La Cour de justice ne s’était prononcée sur la faculté de garder le silence que dans le domaine du droit de la concurrence, et en avait donné une lecture restrictive. Elle refusait de reconnaître cette garantie et affirmait, au contraire, l’existence d’une « obligation de coopération active » pesant sur les entreprises faisant l’objet d’une enquête.Tout au plus, avait-elle admis du bout des lèvres que les enquêteurs ne sauraient imposer à l’entreprise l’obligation de fournir des réponses l’amenant à admettre l’existence de l’infraction. Elle ne reconnaissait qu’un modèle réduit du droit au silence : le droit de ne pas être forcé à avouer.
La question préjudicielle posée par la Cour constitutionnelle italienne plaçait la CJUE devant le choix entre deux attitudes : maintenir sa jurisprudence très réductrice du droit au silence, ou bien l’abandonner pour se rallier à la jurisprudence CEDH en vertu du principe d’homogénéité. Elle en a choisi une troisième : la CJUE décide que la jurisprudence de la CEDH doit s’appliquer lorsque la personne visée par une enquête est une personne physique, et maintient sa jurisprudence antérieure, qui doit s’entendre comme ne visant que les entreprises et non les personnes physiques.
Cette reconnaissance aux personnes physiques du droit au silence, dans certaines limites, au cours d’une enquête administrative, trouvera-t-elle application en matière de contrôle fiscal ?
La Charte peut-elle s’appliquer à un contrôle fiscal ?
3 – La Charte n’est pas la Constitution : elle ne s’applique que quand s’applique le droit de l’UE. La jurisprudence déterminera progressivement les situations dans lesquelles les autorités étatiques doivent se conformer aux droits fondamentaux consacrés par la Charte, en tirant les conséquences des dispositions de l’article 51 qui énoncent que les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres « uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ».
Nul besoin d’être grand devin pour prédire que la Cour donnera un champ d’application large à l’obligation pour les États de respecter la Charte. La question du champ d’application des droits fondamentaux de l’UE n’est d’ailleurs pas tout à fait vierge : les droits fondamentaux ont été reconnus en tant que principes généraux du droit par la Cour de justice, selon une formule jurisprudentielle devenue classique : « les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour de justice assure le respect » ; l’arrêt Consob ne manque pas de le rappeler .
Or, quand sont invoqués devant elle ces principes généraux du droit, c’est la notion de « champ d’application » du droit de l’Union –plus large que celle de « mise en œuvre » – qui commande la compétence de la Cour pour examiner la conformité de la réglementation nationale avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect.
Les critères d’identification de l’existence d’une mise en œuvre du droit de l’Union ont pu être synthétisés comme suit : « Il y a “mise en œuvre” du droit de l’Union au sens de l’article 51, § 1, de la Charte lorsqu’il existe une obligation définie par le droit de l’Union applicable à la situation nationale en cause. Que les autorités nationales exécutent cette obligation (par exemple en transposant une directive, ou en appliquant un règlement européen),ou qu’elles y dérogent. Cette obligation peut également être postérieure à l’adoption de la réglementation nationale ».
À la lumière de cette analyse, on peut tenter l’exercice difficile de répertorier les redressements fiscaux qui se situent dans le champ d’application du droit de l’Union, et doivent dès lors respecter les garanties de la Charte. On pense immédiatement à un redressement en matière de TVA, de régime fiscal commun des fusions, de régime commun des sociétés mères et filiales. Mais ce pourrait être également le cas de tout redressement d’impôt sur les sociétés fondé sur un abus de droit, dont le juge fiscal considérerait qu’il met en œuvre les obligations découlant de la directive ATAD, même si le redressement n’est pas fondé explicitement sur les dispositions de l’article 205A du CGI.
Un redressement fiscal peut également se trouver dans le champ d’application du droit de l’Union dès lors qu’il est susceptible de restreindre l’exercice des grandes libertés fondamentales d’établissement, de prestation de service et de circulation des capitaux, tel qu’un redressement en matière de retenue à la source, d’établissement stable, de siège de direction effective. Et en cas d’adoption des projets de directive concernant l’assiette commune à l’impôt sur les sociétés (ACIS), et l’assiette commune consolidée à l’impôt sur les sociétés (ACCIS), c’est une partie importante des redressements en matière d’impôt sur les sociétés qui basculerait dans le champ d’application du droit de l’Union… et donc de la Charte.
Si les redressements d’entreprise paraissent à première vue les plus susceptibles de mettre en œuvre le droit de l’Union, de simples particuliers pourraient eux aussi être en mesure d’invoquer la Charte à propos de redressements relatifs à des activités menées ou à des actifs détenus dans d’autres États de l’Union, et notamment à propos de litiges en matière de domiciliation réputée fictive, ou fondés sur un dispositif tels que ceux des articles 123 bis ou 155A du CGI, destinés à étendre le bras du fisc au-delà de nos frontières.
Un droit relatif ou absolu ?
4 – Eu égard à la clause d’homogénéité de la Charte, la portée devant être reconnue au droit de garder le silence, tel qu’il découle des articles 47 et 48 de cette Charte, doit correspondre à celle définie par la jurisprudence de la CEDH. Or, la CEDH tempère parfois cette portée. Elle a parfois affirmé que le droit de garder le silence n’est « pas absolu ». L’expression est curieuse s’agissant des garanties de l’article 6, car on voit mal comment le droit à un procès équitable pourrait n’être que relatif : faudra-t-il ne plus parler du droit au procès équitable, mais du droit au procès presque équitable ?
Certes, dans l’affaire Jalloh c/ Allemagne, la Cour a examiné le critère du « poids de l’intérêt public à la poursuite de l’infraction en question et à la sanction de son auteur ». Dans cet arrêt, elle a semblé vouloir relativiser la portée du droit au silence, suscitant une critique ferme du juge Pavlovschi dans son opinion dissidente sous l’arrêt Saunders. La référence, dans l’arrêt Jalloh, à l’intérêt public en jeu, est toutefois restée assez isolée. Dans de nombreuses décisions la Cour a énoncé que l’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation de réponses obtenues de force dans une enquête pour incriminer l’accusé. La complexité des affaires, notamment financières, ne saurait davantage restreindre la garantie. Dans l’affaire Heaney et McGuinness, la Cour énonce :
« La Cour tient dûment compte des préoccupations de sécurité et d’ordre publics invoquées par le Gouvernement. Toutefois, la Cour rappelle que, dans l’affaire Saunders (arrêt précité, p. 2066-2067, § 74), elle n’a pas souscrit à la thèse du gouvernement britannique d’après laquelle la complexité des fraudes dans le domaine des sociétés ainsi que l’intérêt public essentiel à la poursuite de ces fraudes et à la sanction des responsables pouvaient justifier que l’on s’écartât à ce point de l’un des principes fondamentaux d’une procédure équitable. Elle a estimé que les exigences générales d’équité consacrées à l’article 6, y compris le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, “ s’appliquent aux procédures pénales concernant tous les types d’infraction criminelle, de la plus simple à la plus complexe ” ».
La Cour de justice de l’Union européenne allait-elle pencher vers une prise en considération de l’intérêt public, pour contrebalancer et limiter cette garantie ? Dans le passé, elle avait repris de la CEDH la nécessité d’une telle balance entre les garanties de l’accusé et l’ordre public, et dans l’affaire Consob, le gouvernement italien ne manquait pas de le lui rappeler. On constate cependant avec beaucoup d’intérêt
que, cette fois, la CJUE n’est pas entrée dans cette problématique d’une garantie qui ne serait pas absolue car tempérée par l’intérêt public :l’idée d’une telle balance n’est à aucun moment évoquée dans
l’arrêt Consob. Encore la CJUE devait-elle se demander si le droit de se taire au cours d’une enquête administrative relève du « noyau dur du droit pénal ».C’est ce que lui suggérait la Commission, qui soutenait que le principe découlant de l’arrêt rendu par la grande chambre de la CEDH dans l’affaire Jussila c/ Finlande 25 autoriserait une application « tempérée » du droit de garder le silence.
L’arrêt ne répond pas explicitement à cette thèse, mais elle est examinée et réfutée dans les remarquables conclusions de l’avocat général 26, qui a répliqué à la Commission que la CEDH a déjà considéré, dans l’arrêt Grande Stevens et autres c/ Italie 27, que les sanctions adoptées en matière d’agissements anticoncurrentiels relevaient bien du noyau dur du droit pénal, leur caractère infamant résultant du fait qu’elles étaient susceptibles de porter préjudice à l’honorabilité professionnelle et au crédit des personnes concernées.
Nul doute qu’un redressement fiscal leur porte tout autant préjudice, et qu’à cet égard le contrôle fiscal peut relever de ce noyau dur.
Dans quels cas les procédures fiscales doivent-elles respecter cette garantie ?
5 – S’il est certain qu’une procédure de contrôle fiscal n’est pas tributaire des garanties du procès équitable au sens de l’article 6 de la convention EDH, c’est à la condition que la procédure soit exclusivement fiscale, c’est-à-dire qu’elle conduise à des impositions et à des intérêts de retard, mais non à des pénalités. La notion de « matière pénale » a fait l’objet d’une interprétation large par la CEDH, et à cet égard, pratiquement toutes les pénalités prévues par le droit fiscal français entrent dans la matière pénale.
Par ailleurs, la CEDH n’a pas eu d’hésitation à juger que la garantie ne s’applique pas seulement devant un tribunal, mais dès le stade de l’enquête administrative : le droit de se taire n’est pas limité à la phase juridictionnelle de la procédure, il est applicable dès la phase de l’interrogatoire de police 28. Dans son arrêt ici commenté, la CJUE confirme cette approche large, puisque la garantie peut trouver application, à certaines conditions, au cours d’une enquête administrative.
Ceci incite à penser que ce droit peut dans certains cas être invoqué dès le stade du contrôle fiscal. C’est peut-être ce qui a inspiré le législateur lorsque, instituant la procédure d’audition, il a prévu qu’elle ne peut concerner le contribuable dont l’activité fait l’objet d’un recueil d’information (LPF, art. L. 10-0AB).Dans le même esprit, en matière de visite domiciliaire, si les dispositions du III bis de l’article L. 16 B
du LPF autorisent les agents à recueillir sur place des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou du contribuable, c’est à la condition de les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Or, une visite domiciliaire constitue une procédure fiscale, non pénale, et de surcroît antérieure même au contrôle. Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion d’admettre que le moyen tiré de cette garantie est opérant lorsqu’il est dirigé contre la procédure d’établissement d’une pénalité fiscale : le Conseil d’État admet la recevabilité du moyen (non fondé en l’espèce) tiré du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination 29.
La jurisprudence du juge fiscal considère à ce jour que la violation du droit au procès équitable ne peut entraîner la décharge que des pénalités elles-mêmes, et non des droits. Sa position est cependant susceptible d’évoluer : dès lors que c’est la même procédure qui est suivie pour établir les droits et les pénalités, l’idée pourrait s’imposer que c’est la procédure dans son ensemble qui doit être considérée
comme inéquitable. Comme l’expose de façon brillante le professeur Ayrault, la procédure fiscale relève elle-même des garanties de l’article 6 de la Convention EDH lorsqu’elle est commune avec la procédure d’établissement des pénalités fiscales : c’est l’ensemble de la procédure qui tend à une accusation en matière pénale « par absorption » selon son excellente expression 30.
L’article 47 de la Charte vient en renfort de l’article 6 de la Convention EDH, et la poussée de ce renfort pourrait contribuer à élargir l’exigence du procès équitable à l’ensemble du procès fiscal. Ce n’est certainement pas par inadvertance que la CJUE a visé à la fois les articles 47 et 48 de la Charte pour reconnaître le droit au silence 31.
On sait que les garanties de l’article 6 de la Convention EDH ont été éclatées entre deux des articles de la Charte : l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond à l’article 6, § 1, de la Convention EDH, et l’article 48 de la Charte reprend le contenu de l’article 6, § 2 et 3, de la Convention EDH. Les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, établies et mises à jour sous la responsabilité du présidium de la Convention qui a élaboré la Charte des droits fondamentaux, et auxquelles la CJUE se réfère, indiquent à propos de l’article 47 que « dans le droit de l’Union, le droit à un tribunal ne s’applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil ». Les droits garantis par l’article 47 s’appliquent donc au contentieux fiscal. Or, dans l’arrêt Consob, si le droit au silence est rattaché explicitement à la matière pénale, la Cour rattache en revanche cette garantie au droit au procès équitable et vise constamment les deux articles 47 et 48 pris ensemble : elle ouvre la porte à un élargissement de cette garantie au-delà de la matière pénale.
On peut invoquer enfin une autre raison pour laquelle la garantie ne devrait pas être limitée par principe à la contestation des pénalités fiscales. Tout rappel de droits éludés peut conduire, indépendamment des pénalités fiscales, à des poursuites pénales pour fraude fiscale, soit sur dénonciation obligatoire en vertu des dispositions du I de l’article L. 228 du LPF, soit sur plainte de l’administration fiscale, voire d’office par le Parquet poursuivant un « auto-blanchiment » de fraude fiscale par le contribuable 32. Dès lors, c’est l’ensemble de la procédure de contrôle fiscal qui devrait respecter la garantie, puisque la perspective des poursuites pénales n’est jamais absente, tout au moins lorsque le redressement envisagé dépasse le seuil de 100 000 € fixé à l’article L. 228 du LPF.C’est ce à quoi incitent plusieurs arrêts de la CEDH, dont l’arrêt J. B. c/ Suisse analysé ci-dessous, où n’étaient nullement évoquées des pénalités fiscales, mais le risque de poursuites pénales : la cour a pris soin de relever que la procédure aurait amené à constater l’infraction de soustraction d’impôt. L’application du droit au silence à certaines procédures de contrôle fiscal s’impose à mesure que le législateur confie à l’administration fiscale un rôle moteur dans la mise en œuvre de l’action publique. La jurisprudence de la Cour de cassation tend à assimiler l’administration fiscale au Parquet. Dans une remarquable intervention à un colloque de l’Institut du droit pénal fiscal et financier, Stéphane Detraz a exposé que laCour de cassation a exacerbé les effets de la constitution de partie civile de l’administration fiscale pour la rapprocher de l’action du Parquet :
« […] la Cour de cassation a expressément énoncé que l’article L. 232 du Livre des procédures fiscales a pour but de permettre à l’administration de suivre la procédure et d’y intervenir dans l’intérêt du fisc. Cette finalité confirme que l’administration est bien une sorte de parquet spécialisé, qui agit pour la préservation d’un intérêt général spécifique, à savoir les intérêts du Trésor, contre les faits de fraude ».
Et le rôle de l’administration fiscale n’est pas un simple rôle de plaignant, qui serait à égalité d’armes avec le contribuable :
« Son rôle actif dans l’accusation est d’ailleurs souligné en amont, seuls ses écrits sont automatiquement communiqués au parquet à qui revient l’opportunité des poursuites, la circulaire de mars 2019 précisant les modalités de transmission, n’obligeant pas celle-ci à joindre également les écritures du contribuable [notamment la réponse à la proposition de rectification] qui apporteraient des arguments de décharge de sa responsabilité pénale ». Encouragés par cette jurisprudence, les parquets considèrent l’administration fiscale comme l’équivalent pour un délit fiscal d’un des services de police judiciaire qu’ils chargent d’enquêter sur un cambriolage ou un assassinat. Selon la fine expression de Stéphane Detraz, l’administration fiscale est devenue une sorte de parquet spécialisé, chargé de poursuivre les fraudes fiscales.
Au terme d’une intéressante étude consacrée à cette mutation du rôle de l’administration fiscale,Clarisse Sand, souligne que les prérogatives de l’administration fiscale, tels qu’elles ont été renforcées par la loi contre la fraude de 2018, s’assimilent désormais à celles des services d’enquêtes judiciaires, et elle en conclut assez justement que la répression administrative et pénale de la fraude fiscale constitue
une « matière désormais hybride ». Force sera de tirer les conséquences de ce nouveau rôle d’autorité de poursuites imparti à l’administration fiscale : dès lors qu’un procureur lui-même n’a pas le droit d’exiger d’un suspect qu’il fournisse les preuves de sa culpabilité, il devient difficile d’admettre qu’un contrôleur des impôts dispose de tels pouvoirs à l’égard d’un suspect de fraude fiscale. Faut-il qu’une procédure pénale soit en cours ou prévue pour que se déclenche le droit au silence ? Il découle de la jurisprudence de la CEDH que le droit au silence existe dès la phase d’enquête, avant toute instance, si les résultats de l’enquête sont susceptibles d’être utilisés au cours d’un procès pénal : dans l’affaire Saunders, il s’agissait de réponses obtenues par la coercition dans le cadre d’une enquête non judiciaire pour incriminer l’accusé au cours d’un procès ultérieur. Dans l’affaire de la banqueroute d’Air Lib, la Cour n’a pas hésité à appliquer la garantie (sans violation) à une enquête antérieure à toute procédure pénale (affaire Corbet c/ France 35. Devant la CEDH, M. Corbet, condamné pour malversations ayant conduit à la faillite de la sociétéAir Lib, dénonçait une violation de son droit de se taire, et se plaignait que le rapport de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur les causes de la disparition d’Air Lib, transmis au ministère public, avait servi de fondement aux poursuites pénales. En effet, convoqué devant la commission d’enquête parlementaire, il avait été obligé de comparaître, de prêter serment et de déposer sous peine d’encourir deux ans de prison. La CEDH juge le grief recevable, et elle ne l’écarte qu’au motif qu’il n’était pas établi que les déclarations faites devant la commission d’enquête aient eu un impact sur le verdict. Il est donc envisageable que des informations et des productions de documents obtenues au cours d’un contrôle, sous menace d’opposition à contrôle fiscal, et utilisées ultérieurement pour infliger au contribuable des sanctions à caractère pénal, ou pour le poursuivre devant le tribunal correctionnel, mettent en jeu la garantie.
Toute la question est de savoir à quel point la procédure pénale doit être « prévisible ». Des arrêts admettent que la garantie est applicable même si les poursuites pénales ne sont qu’éventuelles. Ainsi jugé dans l’arrêt Shannon, intéressant aux yeux des fiscalistes puisqu’il s’agit d’une enquête financière à raison de soupçons de fausse comptabilité. Il n’était pas certain, au moment de l’interrogatoire, que l’intéressé serait pénalement poursuivi, et le gouvernement britannique soutenait que de ce fait la garantie n’était pas applicable. La Cour écarte cette analyse (souligné par nous) :
« 40. […] la Cour relève que les informations qu’aurait pu livrer le requérant à l’occasion de l’interrogatoire auraient pu être utilisées dans le cadre d’un procès pénal subséquent […] Il est vrai, comme le Gouvernement le relève, que le requérant pouvait ne pas être jugé et que même en cas de procès il aurait été loisible au juge d’exclure les informations obtenues dans le cadre de l’interrogatoire. Ces deux points ont toutefois trait à l’utilisation effective des preuves dans le cadre d’une procédure subséquente, alors qu’il ressort clairement de la jurisprudence précitée qu’il ne faut pas nécessairement qu’une procédure soit intentée pour que puisse jouer le droit de ne pas s’incriminer soi-même ».
Cette problématique est aisément transposable au contrôle fiscal.
Le droit au silence ne permet pas d’échapper à ses obligations déclaratives…
6 – Les obligations déclaratives légales, applicables de plein droit à tous les contribuables, ne sont certainement pas susceptibles de donner lieu à l’application de cette garantie. L’obligation de déclarer ses revenus à l’administration fiscale ne soulève aucune question sous l’angle de cette garantie, même si une sanction est attachée au défaut de déclaration ou au fait de déposer une fausse déclaration. Tant qu’il n’existe pas de procédure pénale en cours ou prévue contre le contribuable, il est tenu de se conformer à des obligations déclaratives qui sont indispensables pour la mise en œuvre du système fiscal.
Il en va de même pour des informations sur les actifs détenus par le contribuable. Ainsi, dans son arrêt Allen 37, la Cour indique que cette garantie n’interdit pas en soi le recours à des pouvoirs coercitifs pour
obliger une personne à produire des informations sur ses actifs ou ceux d’une société dans laquelle elle a des intérêts. Ainsi que s’exprime le juge Pavlovschi :
« la Cour a jugé que l’obligation de déclarer ses actifs à l’administration fiscale ne soulevait aucune question sous l’angle de l’article 6, § 1, alors qu’une sanction était attachée au défaut de cette déclaration et que le requérant avait d’ailleurs été puni d’une amende pour avoir fait une fausse déclaration. La Cour a noté qu’il n’existait pas de procédure pénale en cours ou prévue contre le requérant et que le fait qu’il ait pu mentir pour empêcher le fisc de découvrir un comportement susceptible de donner lieu à des poursuites ne suffisait pas pour faire entrer en jeu le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (Allen c. Royaume-Uni (déc.), no 76574/01, CEDH 2002-VIII) ».
Il nous semble à cet égard qu’il faut distinguer entre les obligations déclaratives des contribuables, qui ne sauraient à l’évidence être limitées par un prétendu droit au silence, et la situation du contribuable qui fait l’objet d’un contrôle au cours duquel l’agent des impôts lui demande des informations nécessaires pour confirmer le bien-fondé du redressement qu’il a, si on nous permet l’expression, « derrière la tête ». Ces informations demandées spécifiquement en vue du redressement, et qui dépassent les obligations déclaratives normales des contribuables, rentrent à notre avis dans le champ de la garantie. Il faut également considérer différemment les déclarations que les contribuables sont tenus de faire à l’administration fiscale de façon systématique et impersonnelle, et les déclarations qui sont demandées individuellement à un contribuable par un contrôleur. Le fait qu’un contrôleur réclame des informations laisse supposer que le contribuable a fait l’objet d’un « ciblage fiscal », selon l’expression étrange mais maintenant consacrée, et qu’est envisagée la possibilité qu’il ait commis une omission ou une fausse déclaration.
En définitive, c’est l’apparition du soupçon qui déclenche l’application de la garantie. Le contribuable interrogé a droit à cette garantie dès lors qu’il n’est pas contrôlé de façon aléatoire ou routinière, mais
en raison d’un soupçon. Le contribuable n’a pas droit à cette garantie en tant que contribuable, mais en tant que suspect. C’est ce qui ressort notamment de l’arrêt Shanon (souligné par nous) : « 38. […] Si l’obligation de se présenter à l’interrogatoire avait été imposée à une personne à l’égard de laquelle les autorités ne nourrissaient aucun soupçon ni aucune intention d’engager des poursuites, l’utilisation des pouvoirs coercitifs prévus par l’ordonnance de 1996 aurait éventuellement pu se concilier avec le droit de ne pas s’incriminer soi-même, comme c’est le cas d’une obligation légale de fournir des informations qui s’appuie sur des considérations de santé publique ».
On pourrait transposer ici l’expression employée par Sylvain Humbert à propos de la procédure d’audition en fiscalité internationale, lorsqu’il évoque l’interdiction d’auditionner le « contribuable dont l’activité est dans le collimateur de l’administration ».
… ni à une condamnation pour fausse déclaration.
7 – Il est jugé que les déclarations faites librement sont opposables : le droit de ne pas témoigner contre soi-même n’interdit pas à l’accusation d’utiliser contre le suspect les propos incriminants qu’il a pu tenir contre lui-même sans aucune contrainte.Par exemple, il est permis de confronter l’accusé à des propos qu’il a tenus spontanément dans une demande d’asile, car cela ne peut s’analyser en l’usage de propos arrachés par la contrainte en violation de l’article 6, § 1 40. Transposée à la matière fiscale, cette jurisprudence implique que l’administration fiscale peut normalement utiliser contre un contribuable ses propres déclarations de revenus et de patrimoine. Si le dépôt de certaines déclarations fiscales est obligatoire sous peine de sanctions, le contribuable reste cependant libre du contenu de ses déclarations fiscales.
Le contribuable peut être tenté de faire une fausse déclaration à l’administration fiscale, mais il encourt alors une condamnation qui ne constituerait pas une atteinte au droit de garder le silence, comme la CEDH a eu l’occasion de le juger. L’intéressé avait été condamné pour avoir adressé une fausse déclaration de revenus à l’administration fiscale : c’est l’infraction elle-même qui était sanctionnée, non un quelconque refus de s’auto-incriminer.En effet « le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne confère pas une immunité générale quant aux actes motivés par la volonté d’échapper à un contrôle fiscal ».
Les questions factuelles sont-elles concernées par le droit au silence ?
8 – De longue date, certains gouvernements ont suggéré à la CEDH d’interpréter sa jurisprudence en distinguant selon que le recours à la contrainte vise à obtenir des déclarations ou des aveux, ce qui est interdit, ou des éléments de preuve « matériels », ce qui serait permis.Sans rejeter formellement cette interprétation, la Cour a émis un doute sur la possibilité d’établir une distinction claire dans toute
affaire entre le recours à la contrainte pour obtenir des déclarations incriminantes, d’une part, et des éléments de preuve « matériels », d’autre part. Dans l’affaire Consob, l’avocat général a exposé à la Cour de justice la même idée, en indiquant que la reconnaissance d’un droit de garder le silence qui couvrirait l’ensemble des questions purement factuelles (« droit de garder le silence absolu ») irait au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les droits de la défense.
Il a souligné que, selon la jurisprudence préexistante de la CJUE, le droit pour une entreprise de garder le silence ne couvre pas les réponses aux questions portant sur des faits, à moins qu’elles n’aient pour objet d’obtenir l’aveu de l’infraction. En d’autres termes, il faut déterminer si une réponse de l’entreprise équivaudrait à l’aveu d’une infraction. Si tel n’est pas le cas, la question est considérée comme
étant « purement factuelle ».
Mais il a souligné que cette jurisprudence, applicable aux entreprises faisant l’objet d’enquêtes relatives à des infractions au droit de la concurrence, ne concerne que les personnes morales. La question ayant trait à la portée du droit de garder le silence des personnes physiques n’avait, quant à elle, jamais été examinée jusqu’à présent par la Cour. Partant de là, l’avocat général a incité la Cour à considérer que le
droit au silence devait nécessairement avoir une portée plus large pour les personnes physiques que pour les personnes morales. En effet, indique-t-il, cette conception restrictive du droit au silence s’expliquait par la mise en balance de ce droit avec l’intérêt public que constitue la répression des infractions au droit de la concurrence. Or, la CEDH a précisé que la portée du droit de garder le silence ne peut pas être réduite par sa mise en balance avec un intérêt de nature publique. Cette orientation a été retenue depuis l’arrêt Saunders c/ Royaume-Uni, dans lequel la CEDH a rejeté la thèse du Gouvernement selon laquelle l’intérêt public essentiel à la poursuite des fraudes dans le domaine des sociétés et à la sanction des responsables pouvait justifier que le droit de ne pas s’incriminer soi-même ne soit pas reconnu à l’accusé.
Partant, la portée du droit de garder le silence des personnes physiques recouvre également les réponses aux questions portant sur les faits qui n’impliquent pas nécessairement un aveu de culpabilité,
mais qui ont un impact sur la motivation de la décision adoptée ou la sanction infligée à l’issue de cette procédure.
La Cour donne implicitement raison à son avocat général. Il ressort en effet par a contrario du rapprochement des points 45 et 46 que, à la différence des entreprises, les personnes physiques ne peuvent être contraintes de fournir des renseignements portant sur des faits ou de communiquer les documents afférents à ces faits, si ceux-ci peuvent servir à établir leur responsabilité pénale.
L’exception relative aux pouvoirs coercitifs légaux
9 – Il est bien établi dans la jurisprudence de la CEDH que le droit de ne pas s’incriminer soi-même ne s’étend pas à l’usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs légaux, tels que les documents saisis lors d’une perquisition. Cette exception est ainsi rédigée, par exemple,dans l’arrêt Saunders c/ Royaume-Uni,de la grande chambre
de la CEDH : « 69. Toutefois,le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d’un accusé de garder le silence. Tel qu’il s’entend communément dans les systèmes juridiques des parties contractantes à la Convention et ailleurs, il ne s’étend pas à l’usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d’un mandat, les prélèvements d’haleine, de sang et d’urine ainsi que de tissus corporels en vue d’une analyse de l’ADN ».
Cette exception s’applique aussi au contenu d’un ordinateur ou d’un téléphone. La Cour de cassation en a fait application à une personne poursuivie pour avoir refusé de communiquer aux autorités judiciaires le code de déverrouillage de son téléphone, ce à quoi l’obligeaient les dispositions de l’article 434-15-2 du Code pénal, et qui invoquait l’atteinte au droit de se taire. LaCour lui dénie cette garantie au motif qu’elle ne s’applique qu’à des données qui ne peuvent exister indépendamment de la volonté du suspect, ce qui n’est pas le cas des données contenues dans les téléphones, lesquelles peuvent être obtenues par des moyens techniques.
Les données que les enquêteurs peuvent obtenir par des procédés coercitifs légaux, indépendamment de la volonté de l’accusé, sont parfois qualifiées d’éléments matériels, et cette notion d’élément matériel revient à plusieurs reprises dans la jurisprudence de la CEDH. Ainsi, dans son arrêt O’Halloran, la Cour parle de « l’exception relative aux preuves matérielles définie dans l’arrêt Saunders ». La Cour semble dans certains arrêts prendre quelques distances à l’égard de cette notion d’élément matériel, et dans le même paragraphe de l’arrêt O’Halloran elle émet un doute sur la question de savoir « si une distinction claire pouvait être établie dans toute affaire entre le recours à la contrainte pour obtenir des déclarations incriminantes, d’une part, et des éléments de preuve “ matériels ” de nature incriminante ».
Dans l’affaire Jalloh c/ Allemagne, également, la Cour prend quelques distances avec ce que l’on peut appeler « l’exception Saunders », lorsqu’elle écrit : « 110. Quant à l’applicabilité en l’espèce du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour observe que se trouve en cause l’utilisation au procès d’éléments de preuve « matériels » – par opposition à des aveux – obtenus par une atteinte portée de force à l’intégrité physique du requérant. Elle relève que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination tel qu’il s’entend communément dans les États contractants et ailleurs concerne en premier lieu le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence au cours d’un interrogatoire et à ne pas être contraint à formuler une déclaration.
Toutefois, il est arrivé à la Cour de donner au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, tel que protégé par l’article 6 § 1, un sens plus large de manière à embrasser des affaires dans les quelles était en litige la contrainte à laquelle les autorités avaient recouru pour se voir remettre des éléments de preuve matériels. Dans l’affaire Funke c. France(25 février 1993, § 44, série A no 256-A), par exemple, elle a dit que les tentatives visant à contraindre le requérant à divulguer des documents et donc à fournir la preuve d’infractions qu’on lui reprochait, avaient emporté violation du droit de l’intéressé de ne point contribuer à sa propre incrimination. De même, dans l’affaire J. B. c. Suisse (§§ 63-71), elle a conclu que la tentative des autorités de l’État de forcer le requérant à soumettre des documents qui auraient pu fournir des renseignements sur une soustraction d’impôt avait méconnu le droit de l’intéressé de ne pas contribuer à sa propre incrimination (dans son sens large) ». La Cour ne récuse pas cette notion, mais elle se demande si cette distinction peut être pertinente « dans toute affaire ». Un exemple évocateur d’élément matériel, qui doit pouvoir être obtenu indépendamment de la volonté de l’intéressé, est donné par le juge Myjer dans son opinion dissidente sous O’Halloran : nul ne saurait s’étonner que le conducteur d’un véhicule puisse être obligé d’avoir sur lui son permis de conduire et de le montrer sur-le-champ à un policier qui le lui demande. En effet, un permis de conduire à « une existence indépendante de la volonté » du conducteur concerné. Et, ajoute le juge, « le permis peut être lu tandis que les lèvres de son propriétaire peuvent demeurer closes ».
Transposons : nul ne saurait s’étonner que le contribuable soit tenu de fournir ses livres comptables, son fichier informatique d’écritures comptables (FEC), son registre des immobilisations, ses relevés de comptes bancaires. Il devrait en aller de même, nous semble-t-il, pour les actes dont l’existence est connue par les déclarations fiscales de ce contribuable : ainsi, si le contribuable a réalisé une acquisition
ou une cession, si une société a réalisé une fusion, l’acte de vente ou le traité de fusion ont une existence avérée et objective, qui autorise le contrôleur à en exiger la communication. Il importe en effet de savoir si les documents demandés par les enquêteurs ont une existence certaine, en ce sens qu’ils doivent être
détenus par les intéressés en application d’une obligation légale. C’est ainsi que dans l’affaire Funke c/ France, la Cour a constaté que : « [L]es douanes provoquèrent la condamnation de M. Funke pour obtenir certaines pièces, dont elles supposaient l’existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un autre moyen, elles tentèrent de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d’infractions qu’il aurait commises. Les particularités du droit douanier ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout“ accusé ”au sens autonome que l’article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination ».
À l’aune de ce critère, le contrôleur ne saurait exiger du contribuable qu’il communique des courriers, des notes internes, des rapports et avis reçus de tiers, bref des documents qui n’existent pas nécessairement, ou qui existent mais dont l’existence était purement facultative. On est tenu d’avoir un permis de conduire lorsqu’on conduit une automobile, on est tenu de tenir une comptabilité selon son activité, mais on n’est pas tenu d’écrire à ses clients, d’échanger des notes internes ou de demander des business plans à des auditeurs et des valorisations à des évaluateurs. Encore moins le contrôleur pourrait-il exiger que le contribuable réponde à des questions tendant à lui faire révéler des faits, des considérations ou des circonstances que le contrôleur ignore. Sur la question de savoir jusqu’où l’administration fiscale peut aller dans ses demandes de documents, l’affaire J. B. c/ Suisse est particulièrement instructive. Dans cette affaire, l’administration fédérale des contributions ayant constaté que le contribuable avait effectué des investissements dans certaines sociétés, et que les revenus de ces investissements n’avaient pas été déclarés, réclama au contribuable tous les documents en sa possession ayant trait à ces sociétés. Il reconnut avoir effectué des investissements et n’en avoir pas déclaré les revenus, mais il ne produisit pas les documents requis ; et surtout, invité à déclarer la source des investissements, il ne répondit pas. Cela provoqua l’ire du fisc suisse, qui espérait imposer non pas tant les produits de ces investissements que le montant des investissements, réputés financés par des revenus non déclarés. L’administration lui infligea une amende modérée de 1 000 CHF. L’intéressé paya cette amende. L’intéressé n’ayant toujours pas fourni les renseignements demandés, il fit l’objet d’une 2e puis d’une 3e amende. Emporté par cette avalanche d’amendes, il forma finalement des recours.
La Cour constate que les autorités ont tenté de contraindre le requérant à soumettre des documents, et que tout revenu de sources non imposées que ces documents feraient ressortir serait susceptible de constituer l’infraction de soustraction d’impôt. Elle estime que les informations dont il s’agit se distinguent de données qui existent indépendamment de la volonté de la personne concernée, comme celles évoquées par la Cour dans l’affaire Saunders 47 ; le fisc suisse ne pouvait dès lors pas les obtenir en recourant à des pouvoirs coercitifs, au mépris de la volonté de l’intéressé. En conséquence, et eu égard au caractère répétitif de ces amendes, la Cour estime qu’il y a eu violation du droit consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de ne pas s’incriminer soi-même.
La solution tient à ce que l’administration ne demandait pas seulement des documents déterminés mais des informations sur l’origine des fonds investis. Telle semble devoir être la ligne de partage : oui aux demandes de documents existants (ou dont la détention est obligatoire), non aux demandes de renseignements portant sur des documents dont l’existence est hypothétique.
Redéfinir l’opposition à contrôle fiscal
10 – Avec sa vigueur habituelle, le professeur Gilles Noël dénonce la proclamation spontanée par l’administration d’une « obligation de coopération du contribuable » : « L’administration fiscale mentionne de plus en plus souvent l’existence d’une obligation de coopération entre le service des impôts et le contribuable lors des contrôles fiscaux. […] Mais la “ coopération ”dont il s’agit apparaît un peu particulière, pour ne pas dire singulière : il ne s’agit pas d’une démarche concertée et commutative, mais d’une“ obligation ”purement unilatérale de justification du contribuable au [seul] profit de l’administration fiscale. Elle aboutit à la mise en place d’un système “ auto-incriminant ” qui suscite les plus expresses réserves et qui est condamné par la Cour européenne des droits de l’homme ».
Le débat oral et contradictoire change alors de nature, comme l’a relevé un auteur, puisque « l’administration tente d’utiliser le débat oral et contradictoire accordé aux contribuables à son propre profit en le transformant en une simple obligation de coopération du contribuable », et que « le débat initialement présenté comme une garantie offerte aux contribuables tend à devenir une prérogative reconnue à l’administration permettant d’approfondir ses contrôles ».
Ce constat est très juste, et ce système « auto-incriminant » s’appuie sur des sanctions redoutables auxquelles même un contribuable de bonne volonté peut être exposé de façon discrétionnaire, étant donné le caractère vague et indéfini de cette obligation de coopération.
Il existe deux types de sanctions susceptibles de contraindre un contribuable à donner à l’administration des informations et documents qui pourront contribuer à son incrimination : les sanctions en matière de droit de communication, d’une part, et en matière d’opposition à contrôle fiscal, d’autre part.
Le droit de communication, dont on sait qu’il peut s’exercer à l’égard du contribuable lui-même, a reçu depuis quelques années une extension considérable. Le législateur a inséré un ajout de quelques mots à l’article L. 85 du LPF, par lequel le champ de ce droit de communication est devenu sans limite à l’égard des entreprises. La rédaction donnée à cet article par la loi de finances rectificative pour 2014, visant selon son exposé des motifs à « clarifier » le périmètre de ce droit, a étendu ce périmètre à « tous documents relatifs à leur activité ». Toutes les informations et tous les documents de l’entreprise étant, dans la pratique, relatifs à son activité, il n’y a plus, depuis le 1er janvier 2015, aucune limite au droit de communication, si ce n’est le courrier personnel qui peut se trouver accidentellement dans un tiroir. Ainsi s’est réalisée sans débat une extension vertigineuse de l’étendue du droit de communication, officialisant des pratiques administratives à l’époque illégales, et qui commençaient à susciter des contestations. Au lieu de saisir cette occasion de réguler ces pratiques, le législateur les a validées, en croyant « clarifier ».
Au surplus, les demandes du vérificateur peuvent être vastes ou vagues, ce qui oblige l’entreprise à des recherches importantes et parfois à la transmission de documents nombreux. Il n’est pas rare qu’une entreprise reçoive un droit de communication dont l’objet est ainsi libellé : « Le détail des prestations effectuées auprès de la société X » sur plusieurs années, ou bien, encore plus angoissant : « tous documents relatifs à… », formulation très en vogue. Soumise à une demande aussi imprécise, l’entreprise risque en toute bonne foi de ne pas fournir la totalité des documents « relatifs à » la question qui
intéresse le contrôleur. On peut dire qu’aujourd’hui le droit de communication de l’administration, exercé sans aucun formalisme et pratiquement sans limite, sans être réservé aux agents d’un niveau hiérarchique suffisant, et sans aucun recours efficace puisque la sanction tombe avant que le contribuable ait pu faire apprécier par un juge la régularité de la demande, pose un véritable problème au regard des droits fondamentaux. C’est particulièrement vrai au regard du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, lorsque le droit de communication est exercé à l’égard du contribuable lui-même, préalablement à un contrôle.
Les sanctions pour opposition à contrôle fiscal sont de plus fort susceptibles de constituer des contraintes méconnaissant le droit au silence. Lors d’un contrôle, le service peut exiger d’accéder à l’en-
semble des documents détenus par ce contribuable. La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale 50 a institué le droit pour les agents de l’administration fiscale de prendre copie de tous « documents dont ils ont connaissance » dans le cadre d’une vérification de comptabilité. En cas d’opposition du contribuable, une amende lui est infligée, par l’agent des impôts, sans même l’intervention d’un juge. Cette prérogative s’étend non seulement à la vérification de comptabilité, mais également à l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP), dont la jurisprudence affirme pourtant, ou affirmait jusqu’alors, qu’il n’avait pas de caractère contraignant. Selon l’exposé des motifs de l’amendement, cette mesure « a pour objet de mettre fin à une pratique non coopérative de certaines entreprises qui refusent de donner des copies ou l’autorisation de prendre ces copies au service vérificateur ». Ce que l’auteur de l’amendement appelle une « pratique non coopérative » n’était souvent que le simple exercice du droit de ne pas s’auto-incriminer. En effet, ces dispositions rédigées en termes extrêmement vagues (ce qui soulève la question de leur constitutionnalité) ne fixent aucune limite à la consistance des documents dont les agents « ont connaissance ». Au lieu de préciser que cette obligation ne s’étend qu’aux livres et documents obligatoires, l’amendement permet aux agents de demander toutes sortes de documents, sans aucune limite. Le législateur ne pourra guère aller plus loin dans le droit pour le vérificateur de tout savoir, sauf à autoriser le détecteur de mensonges ou le sérum de vérité.
À la menace de sanctions administratives, peut s’ajouter celle d’une poursuite pénale : le contrôleur peut faire usage de l’article 1746 du CGI, qui incrimine « le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions » : le tribunal correctionnel peut prononcer, outre une amende de 25 000 €, une peine de 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive.
L’affaire Zacharias a mis en lumière que le simple fait de ne pas communiquer un document peut être considéré comme mettant le contrôleur dans l’incapacité d’accomplir ses fonctions : le rapporteur public a indiqué au Conseil d’État 51 que le service avait réussi à obtenir de la société Vinci les documents qu’elle avait refusé d’abord de lui donner, au moyen d’une plainte contreVinci pour opposition à fonctions. L’enquête préliminaire déclenchée par le procureur a eu raison de ce refus, puisque la société Vinci a communiqué au procureur les documents qu’elle ne s’estimait pas tenue de transmettre à l’administration, à la suite de quoi le procureur a classé la plainte sans suite. Cette affaire illustre un procédé discutable, consistant à instrumentaliser le procureur, dont le rôle devrait être en principe de poursuivre les infractions constituées plutôt que se faire l’auxiliaire du contrôle fiscal en ouvrant et clôturant des poursuites selon que le contribuable accepte ou refuse les demandes du contrôleur. Ainsi le contribuable qui refuse d’obtempérer à deux demandes successives du contrôleur (rien n’interdit que cette récidive se produise au cours du même contrôle) peut être conduit en prison. Ainsi s’éteindra toute velléité du contribuable d’exercer son droit au silence. Aucun de ces dispositifs ne prévoit de garde-fou permettant de respecter le droit du contribuable de garder le silence sur des éléments d’information qui pourront servir à le sanctionner. Au vu de l’arrêt Consob de la CJUE ici commenté, le juge, tant fiscal que pénal, sera conduit à redéfinir la notion d’opposition à contrôle fiscal.
Malheur aux sociétés ?
11 – Reste à se demander si le droit de ne pas s’auto-incriminer est invocable par une société, ou si cette garantie est réservée aux particuliers. L’arrêt ici commenté semble ne consacrer le droit au silence que pour les personnes physiques : en effet, la Cour indique que son arrêt n’est pas de nature à remettre en cause sa jurisprudence en matière de concurrence, selon laquelle l’entreprise peut être contrainte de fournir tous les renseignements nécessaires, même s’ils peuvent servir à établir l’existence d’un comportement anticoncurrentiel. La Cour se contente de juger cette fois que cette jurisprudence contraignante « ne peut pas s’appliquer par analogie lorsqu’il s’agit d’établir la portée du droit au silence de personnes physiques ». Remarquons au passage qu’une entreprise n’est pas nécessairement une personne morale et que le distinguo de la Cour, entre personnes physiques et entreprises, est un peu bancal. Ce distinguo embarrassé risque de lancer un débat : jusqu’à quel point la Charte des droits fondamentaux est-elle invocable par les personnes morales, et faut-il distinguer selon les garanties ?
C’est une controverse qui a eu lieu en son temps à propos de la Convention EDH, et qui s’était cristallisée sur le droit au respect du domicile protégé par l’article 8 de la Convention. Certains gouvernements voulaient réserver ce droit aux personnes physiques, et certains auteurs, plus sensibles à la défense des veuves et des orphelins qu’aux malheurs des capitalistes, avaient opiné qu’après tout la Convention
visait les droits de l’homme, et que les entreprises ne sont pas des hommes. Après quelques hésitations, la CEDH a finalement consacré en 2002, par son fameux arrêt Sté Colas c/ France 53, le droit des per-
sonnes morales au respect de leur domicile. Quelques mois après, la Cour de justice de l’Union européenne lui emboîtera le pas avec son arrêt Roquette Frères. Après tout, les entreprises font vivre les
hommes.
À la lumière de l’arrêt Consob, les personnes morales ne bénéficient que d’un droit au silence atténué, à avoir le droit de ne pas reconnaître l’existence d’une infraction. Cette restriction infligée aux entreprises semble propre au droit de la concurrence, puisqu’elle trouve sa source dans des textes de droit dérivé, une directive et un règlement, relatifs aux abus de marché. Mais comment le droit dérivé peut-il brider les garanties reconnues par la Charte des droits fondamentaux ? C’est l’œuf qui en remontre à la poule.
Vers l’application de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à la matière fiscale ?
12 – L’élargissement des exigences du procès équitable au-delà de la matière pénale, y compris à la matière fiscale, que réalise la CJUE au moyen de la Charte, pourrait conduire le Conseil d’État à réexaminer son choix prétorien d’exclure le contentieux fiscal du champ de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le Conseil d’État n’est pas impatient de voir la procédure administrative d’établissement de l’impôt soumise aux principes constitutionnels des droits de la défense et du droit à un procès équitable. C’est à ce titre que le Conseil d’État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel plusieurs QPC mettant en cause la procédure administrative d’établissement de l’impôt au regard de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’applicabilité de cet article au contentieux fiscal interdirait notamment la technique déloyale de la substitution de base légale, qui permet au service, au moment où son redressement est reconnu infondé par le juge, d’en invoquer un autre, qui n’a fait l’objet d’aucun contradictoire au cours de la procédure administrative. Cette faculté s’exerce nonobstant les règles de prescription, et l’administration se trouve autorisée (voire incitée) à n’ouvrir le véritable débat qu’après des années de débats, qui se révèlent sans objet, limitant les échanges sur le vrai sujet à un bref échange de mémoires devant le juge. Cette faculté de rattrapage –pour ne pas dire de replâtrage – d’un redressement indu méconnaît les droits de la défense, et la Cour de cassation refuse à l’administration cette facilité : le juge fiscal judiciaire reconnaît au service le droit de modifier le fondement juridique des rectifications auxquelles il souhaite procéder, mais à condition d’agir dans le délai de reprise, de respecter les spécificités éventuelles de la procédure liée au fondement retenu, et d’en aviser le contribuable par une nouvelle proposition lui ouvrant un nouveau délai pour en discuter le bien-fondé et en apprécier les conséquences. De même, la technique de la substitution de base légale ne fera jamais bon ménage avec les garanties que la CJUE vient de rappeler, puisque le contribuable peut se voir opposer de nouveaux motifs de redressement directement devant le juge, souvent après 4, 8 voire 12 ans de contentieux : elle méconnaît le droit du contribuable à une procédure administrative contradictoire lui permettant de se défendre avant que ne soit adoptée la décision de l’ad-
ministration.
Mais jusqu’à ce jour, le Conseil d’État entend faire échapper le contentieux de l’impôt au champ d’application de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, s’inspirant sans doute de la jurisprudence selon laquelle ce contentieux échappe – sauf en matière de sanctions – au champ d’application de l’article 6 de la Convention EDH. Pourtant, comme l’a remarqué récemment Thierry Pons, rien dans l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne limite la garantie des droits aux questions répressives, et le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur cette question, faute que lui soit transmise aucune QPC, puisque le Conseil d’État s’en fait juge à la place du juge constitutionnel.
C’est pour rapatrier en France le contrôle des droits fondamentaux, dans le prétoire du Conseil constitutionnel, qu’a été instituée la QPC. Mais ce but est manqué, et ce contrôle reprend le chemin de l’exil, lorsque le mécanisme de la QPC est enrayé par des refus de transmissions, et que le Conseil constitutionnel est privé de parole. Alors la Cour de justice de l’Union européenne est appelée à remplir le rôle qui devrait être celui de notre juge constitutionnel. C’est ce qu’elle vient de faire de façon spectaculaire par son arrêt Consob.