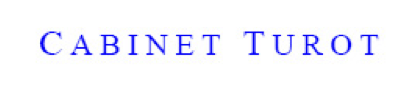1 – Par ces deux décisions, dont la première sera publiée au Lebon, le Conseil d’État prend enfin position sur les questions de fond que pose la première affaire Wendel (à distinguer de l’affaire Wendel-Editis),mettant en cause le traitement fiscal du gain réalisé par les dirigeants lors de l’acquisition de titres de la société Wendel Investissement.
Jusqu’alors en effet, le Conseil d’État n’avait tranché dans cette affaire que des questions de procédure : procédure fiscale lorsqu’il a, en juin dernier, cassé les arrêts rendus à propos des deux principaux dirigeants, pour erreur dans l’application de la garantie prévue à l’article L. 76 B du LPF ; procédure juridictionnelle lorsqu’il a, en décembre, annulé les arrêts rendus dans neuf autres cas pour
irrégularité de la procédure suivie devant la cour. La première partie de cette décision, qui concerne la mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit, suscite des inquiétudes, exposées par Régis Vabres dans sa note mettant en lumière l’explosion du champ d’application de l’abus de droit qu’entraîne l’emploi des mots (on n’ose même pas dire concepts) « montage » et « artifice », mots mous, dont on ne sait pas d’ailleurs s’ils sont alternatifs, cumulatifs, voire vaguement synonymes.
Rassurante au contraire est la seconde partie de la décision, qui apporte un peu de sécurité juridique aux cadres qui investissent dans leur entreprise (s’il est possible d’abandonner l’expression tendancieuse de management package). Si la décision reflète bien le sens des conclusions d’Anne Iljic, remarquables sur ce second volet, c’est la fin du « Tout noir ou tout blanc », c’est-à-dire du raisonnement binaire adopté par la cour.Selon la cour en effet, le gain réalisé par le cadre qui a investi dans son entreprise ne peut pas être fractionné entre deux catégorie de revenus : il est soit tout salaire, soit pas du tout salaire.
Le « Tout noir ou tout blanc » n’a jamais été une position du Conseil d’État, et n’est pas toujours, loin de là, celle des services vérificateurs : la DNVSF pratique depuis longtemps des requalifications partielles, proportionnelles à l’avantage salarial (égal en principe au taux de décote sur le prix du titre) dont a bénéficié le cadre, et seuls certains services moins experts procèdent de façon manichéenne en requalifiant l’ensemble du gain en salaire dès lorsque les salariés ont bénéficié d’un quelconque avantage financier lors de la souscription des titres. Cette attitude binaire a été celle de
la cour dans l’affaireWendel : elle a estimé que dès lors que le salarié n’a pas pris un risque véritable, c’est la totalité de son gain qui doit être regardée comme un complément de salaire imposable. Aussi
était-il très important que le Conseil d’État se prononce sur cette alternative, d’importance pratique majeure : une chose est de se demander à quelles conditions l’Administration peut mettre en
œuvre l’abus de droit, une autre, encore plus importante pour les intéressés, est de déterminer l’étendue du redressement. À dire vrai, la position adoptée par la cour, consistant à imposer en salaire le gain dans sa totalité, alors que l’Administration ne l’avait requalifié qu’en partie, trouve peut-être son origine dans une péripétie contentieuse. La cour était confrontée à un moyen de procédure, tiré de la garantie de l’article L.76 B du LPF.Pour déterminer la proportion du gain à requalifier en salaire, le service avait utilisé un rapport de la banque ABN Amro qui lui avait permis de distinguer la quote-part du gain devant être taxé en salaire de celle relevant à ses yeux d’une autre catégorie ; mais il avait refusé aux contribuables la communication de ce rapport, ce qui aurait dû entraîner la nullité de la procédure. Visiblement soucieuse d’éviter cette conséquence, la cour a suscité, par la communication aux parties d’un moyen d’ordre public, une demande de substitution de base légale (SBL) suggérant que le service aurait dû requalifier en salaire la totalité du gain.
La communication par la cour du moyen d’ordre public, tiré d’une erreur de qualification catégorielle, et impliquant que la totalité du gain aurait dû être imposée en salaire, a provoqué la demande de SBL qu’elle souhaitait (Anne Iljic a relevé, sans en tirer curieusement de conséquence, que « la formulation de ce moyen faisait certes mention du parti d’imposition qu’aurait dû prendre l’Administration au lieu de se borner à relever l’erreur de rattachement catégoriel commis »). La cour a estimé que cette SBL (à la-
quelle elle a, sans surprise, immédiatementfait droit) permettait de purger le vice tiré du défaut de communication du rapport de la banque ABN Amro utilisé pour déterminer la quote-part du gain
taxée en salaire.
Mme Iljic s’est demandé si la cour avait eu raison d’admettre la demande de SBL faite par le service en réponse à cette communication un peu trop suggestive. Elle a relevé la gêne que fait naître une telle utilisation d’un moyen d’ordre public pour susciter une de mande de SBL destinée à sauver une imposition : « Il est vrai qu’une telle séquence apparaît de prime abord comme un contournement
de l’interdiction faite au juge d’y procéder d’office en suscitant une demande de la part de l’Administration ». Elle n’a cependant pas censuré cette procédure artificielle, en se fondant sur une conception très souple (peut-être trop) du maniement d’une SBL, tout en admettant : « On comprend le sentiment de frustration qu’elles peuvent nourrir chez les requérants lorsqu’elles précèdent immédiatement le dénouement d’un litige ayant donné lieu à des échanges fournis entre les parties, mais sur le terrain initialement retenu par l’Administration ».
Toujours est-il qu’au terme de ce passe-passe procédural, la cour avait adopté le raisonnement binaire, qui était en réalité le sien et auquel l’Administration ne s’était ralliée qu’à reculons et à titre subsidiaire : il n’y a pas de fractionnement possible du gain, qui bascule entièrement dans la catégorie salaire au moindre signe d’une volonté d’intéressement. Elle a ainsi jeté le trouble dans la pratique administrative, qui est dans l’ensemble plus subtile, donc plus raisonnable et mieux adaptée à la réalité financière. Quand on mesure à quel point sont fatalement contestables les valorisations des options sur titres (BSA, actions de préférence donnant le droit de souscrire des titres, etc.) qui sont le plus souvent utilisées dans les plans d’actionnariat des cadres, on ne peut que s’inquiéter du raisonnement binaire de la cour. Il est en effet toujours possible au vérificateur de contester la valorisation retenue, même si elle a fait
l’objet d’un rapport d’évaluation, et d’y opposer une valorisation supérieure ; la plus légère divergence d’estimation, permet alors au vérificateur de faire état d’un avantage financier consenti au salarié
et par voie de conséquence, si l’on suit cette logique binaire, de requalifier en salaire la totalité du gain.
On retiendra des conclusions d’Anne Iljic cette affirmation qui apaisera le trouble créé par la cour : « Contrairement à la cour, la démarche de l’administration fiscale consistant à identifier la fraction du gain résultant de l’existence d’un avantage à caractère financier consenti aux contribuables en rémunération de leur travail ou de leurs performances nous paraît pertinente ». Par exemple, si le cadre a eu la possibilité d’acquérir pour le prix de 10 un BSA dont la valeur réelle était de 15, le gain ne serait requalifiable en salaire que pour un tiers de son montant.Mme Iljic apporte des précisions, destinées au juge de renvoi, sur la façon dont il devra calculer cette fraction du gain susceptible d’être considérée comme une rémunération du travail des cadres et non de leur investissement capitalistique. Enfin elle achève sur ce point en indiquant que « Seule la fraction du gain résultant d’un tel avantage peut à nos yeux être taxée dans la catégorie des traitements et salaires, ce qui exclut par construction celle qui trouverait sa source dans la variation du cours d’un titre sur le marché ».
Le Conseil d’État dans cette décision ne prend pas position explicitement sur le débat entre l’imposition de la totalité du gain ou seulement de la fraction qui a été anormalement bonifiée : il se borne à censurer l’erreur de droit commise par la cour en ne recherchant pas si les cadres avaient bénéficié d’un avantage financier, consenti à raison de leurs fonctions, « dont procéderait le gain ».
Ces trois derniers mots contiennent cependant comme un écho de l’exigence de traçabilité exprimée par son rapporteur public.
2 – Si la formation de jugement ne se prononce pas sur le raisonnement binaire de la cour, sa décision comporte en revanche un enseignement novateur, et bienvenu, sur la combinaison des trois critères classiques de la distinction entre intéressement salarial et gain capitalistique (plus-value ou revenu de capitaux mobiliers) : c’est d’ailleurs sur cette question de fond, croyons-nous, que l’arrêt n° 421444 sera fiché et publié au Lebon.
Le critère déterminant ne doit pas être le lien avec le contrat de travail, ni même l’aléa de l’investissement, mais l’avantage dont les cadres ont pu bénéficier lors de leur investissement. Ainsi s’exprime Anne Iljic, synthétisant la jurisprudence Gaillochet : « ce n’est que parce que les sommes en cause trouvaient leur source dans l’avantage concédé au contribuable consistant en la faculté d’acquérir des titres à des conditions préférentielles que vous leur avez reconnu le caractère de traitements et salaires. Si en revanche elles avaient constitué la rémunération d’un apport en capital, elles auraient dû, comme l’expliquait votre rapporteur public Emmanuelle Cortot-Boucher, être regardées comme un revenu d’actions ».
Le Conseil d’État prend le contrepied du raisonnement de la Cour qui, s’écartant du redressement tel que l’avait conçu le service, avait refusé de tenir compte de la minoration du prix de l’option : la cour avait regardé cette minoration comme indifférente à la qualification salariale du gain.
L’apport, explicite celui-ci, de cette décision est d’enseigner aux juges du fond comment pondérer les trois critères qui peuvent concourir à cette requalification, et de ne donner qu’un caractère secondaire aux deux autres questions que la jurisprudence prescrit de se poser : l’investissement a-t-il été réservé aux cadres de l’entreprise ? Le cadre a-t-il pris un risque en réalisant cet investissement ? Ces deux critères sont nécessaires, mais non déterminants.
Sur le premier, Annie Iljic a été très claire : « la circonstance que l’entrée au capital de CDA n’ait été ouverte qu’aux cadres de WI étant sans doute de nature à caractériser l’existence d’un lien avec
l’employeur, mais non à influer sur la nature des sommes en cause ». Un peu plus loin, le rapporteur public achève de marginaliser ce critère en constatant que le fait que les bénéficiaires de management packages sont ceux qui sont aux commandes de la société (c’est toujours le cas par hypothèse), et que c’est leur propre travail qui permet de développer l’entreprise et donc de donner de la valeur à leurs titres, n’est « pas de nature à justifier une requalification en salaires, sauf à dire que l’ensemble des gains de management package devraient être imposés comme tels, car le fait d’inciter les dirigeants à participer, par leur action, à la valorisation de la société qui les emploie est le propre de ces dispositifs ».
Il est même permis d’espérer la quasi-disparition de ce critère peu éclairant : en dehors des sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, il n’est guère concevable que l’accès au capital d’une société soit offert au tout-venant. Une société n’ouvre pas son capital à qui veut, une affectio societatis est nécessaire : dans bien des cas, la mise de fonds du souscripteur ne sera pas suffisante pour le faire
agréer, car on attend également de lui la synergie que va créer son entrée au capital, les compétences qu’il va apporter au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, etc. La décision d’ouvrir le capital de la société à ses cadres, et à eux seuls, relève d’une logique analogue. Le motif rebattu de redressement, qui fait mine de s’étonner que l’investissement n’ait pas été proposé à toute la place, mais
uniquement aux cadres, enfonce une porte ouverte.
L’analyse du risque assumé parle salarié n’est pas délaissée mais, selon Mme Iljic, ce critère se rattache à celui de l’avantage consenti :
« L’absence ou le caractère modéré du risque pesant sur la réalisation du gain, mobilisée à plusieurs reprises parle comité de l’abus de droit fiscal pour déterminer la nature salariale de revenus […], nous
paraît devoir être rattachée à cette notion d’avantage. En couvrant partiellement ou totalement son salarié contre le risque auquel il serait exposé s’il se comportait en investisseur, l’employeur lui
consent bien un avantage de nature financière se traduisant par un gain assimilable à un salaire ».
Ainsi Mme Iljic marginalise le débat sur le risque pris par les dirigeants de Wendel : « Quoi qu’il en soit, l’absence ou le caractère modéré du risque encouru par les contribuables ne nous paraît pas
suffire à commander la requalification en traitements et salaires dès lors qu’il ne résulte pas d’un avantage qui leur aurait été consenti à raison de leurs fonctions ». C’est un retour aux fondamentaux : en
matière de salaire, ne sont imposables que les rémunérations en numéraire et les avantages en nature, pour leur valeur. Cette décision, discutable au regard de la théorie de l’abus de
droit, est en revanche novatrice et empreinte de réalisme sur les questions de fond. Les cadres qui investissent dans leur entreprise ont en effet un urgent besoin de sécurité fiscale.